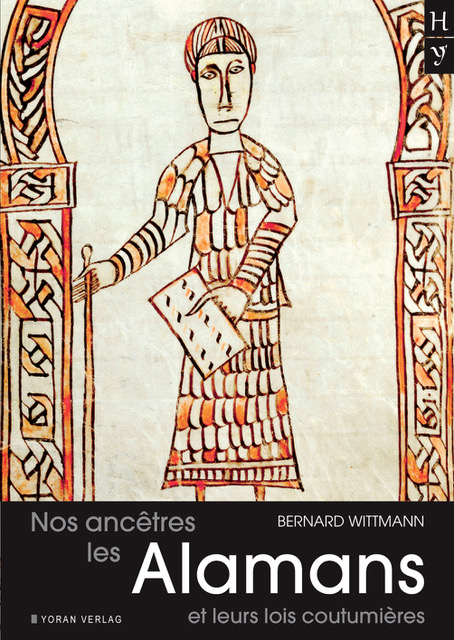La tragédie alsacienne de l’incorporation de force
L’incorporation de force, promulguée le 25.8.1942 par le Gauleiter Wagner en violation du droit international, apparait dans l’histoire alsacienne comme un drame absolu. Elle est ressentie d’autant plus douloureusement en Alsace que la reconnaissance par la France des souffrances infligées à toute une jeunesse alsacienne, contrainte d’endosser l’uniforme allemand pour être jetée dans la mêlée guerrière, se fit longtemps attendre : 100 000 Alsaciens[1] et 30 000 Mosellans, appelés les Malgré-nous, furent concernés par ce qu’on qualifia dès 1945, au procès de Nuremberg, de « crime de guerre ». Parmi eux, des jeunes de 16 à 18 ans ! Cependant, par son ampleur[2] et le nombre des victimes, 40 000 à 47 000 Alsaciens et Mosellans, il est plus juste de parler de « crime contre l’humanité »[3].
Dans cette tragédie qu’on leur infligea, ces hommes connurent les tourments d’une guerre totale et sans pitié : ils connurent l’enfer, notamment sur le front de l’Est où les Alsaciens étaient affectés très majoritairement ! Et même après la reddition de leurs unités, pour ceux d’entre eux envoyés en captivité dans les terribles camps russes, notamment celui de Tambov géré par le NKVD[4] et érigé en lieu de souffrance où rôdait la mort, leur calvaire allait continuer encore longtemps. 15 000 Malgré-nous A-L séjournèrent dans le sinistre camp de Tambov où 3 000 à 6 000 d’entre eux, selon les sources, laissèrent la vie.
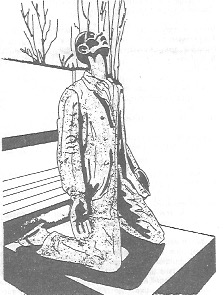
À Mulhouse, monument à la mémoire des Malgré-nous de Tambow (inauguré le 23.4.1983)
De mauvais Français
Pour avoir été de facto dans le camp de l’ennemi, ils passeront pour de mauvais Français en France où on ne se soucia donc guère de leur sort et encore moins de leur libération. Les priorités étaient alors ailleurs. Et pourtant, des centaines de vies alsaciennes auraient pu être sauvées si la France, au lieu de tergiverser comme pour leur faire payer un crime qu’ils n’avaient pourtant pas commis, avait entrepris immédiatement les démarches nécessaires auprès des Russes pour les faire libérer.
C’est qu’à Paris, on n’était pas pressé de les revoir dans une Alsace libérée et en pleine épuration. Aussi, en URSS, les Malgré-nous attendront-ils encore durant des mois leur libération, ce qui ne fera qu’accentuer leur souffrance et le nombre des morts. D’ailleurs, lors de son voyage à Moscou fin 1944 pour rencontrer Staline, le général De Gaulle n’aborda même pas la question de la libération des Malgré-nous détenus dans les camps russes. Ce n’est qu’à l’été 1945, suite à la signature d’un accord franco-soviétique (29.6.1945) que débutèrent les premiers rapatriements[5].
Un rapatriement au compte-gouttes et un lourd bilan humain
Le rapatriement des rescapés des différents camps s’effectua donc au compte-gouttes et ne s’acheva que le 13 avril 1955 avec la libération de Jean-Jacques Remetter. Et c’est dans un état sanitaire très critique, épuisés et décharnés suite aux pénuries alimentaires, qu’ils arrivèrent dans les centres de regroupement. Nombre d’entre eux étaient atteints de maladies. Certains corps n’étaient pas sans rappeler ceux des camps de concentration.
Au total, ce sont 40 000 Alsaciens et Mosellans qui ne revinrent pas de la guerre. Environ 10 500 sont morts en captivité.
Une totale incompréhension en France
Mais en France, où les communistes sont alors au plus haut et où règne une atmosphère résistancialiste, l’incompréhension est totale pour la situation de ces Alsaciens. Socialistes et communistes se montrèrent les plus suspicieux, voire les plus hostiles, à leur égard. Les communistes surtout car ils craignaient qu’ils ne révèlent l’horreur des camps et la misère de la population russe.
De retour en Alsace, les rescapés se verront donc traités en parias, rejetés par le monde combattant français et culpabilisés pour l’uniforme qu’on leur avait imposé[6]… mais aussi pour leur germanité[7]. Leur culture n’était-elle pas liée à celle de l’ennemi ? Aussi seront-ils contraints de raser les murs et de faire profil bas, la honte au ventre. De la naîtra un sentiment de culpabilité. À la souffrance physique dans les camps, venait s’ajouter la souffrance morale.
L’indemnisation tardera outrageusement
Les milieux gaullistes leur donneront alors l’espoir que, contre un patriotisme démonstratif, ils pourraient se voir accorder l’absolution du « crime »… qu’ils n’avaient pourtant pas commis. Mais aussi, ils leur feront miroiter l’espoir de toucher des indemnités grâce aux démarches que le parti gaulliste ne manquera pas d’entreprendre auprès des Allemands. Or, ces derniers avaient pourtant la conviction d’avoir déjà versé à l’État français une dotation globale au titre des réparations aux victimes du nazisme, selon les termes de l’accord franco-allemand du 15.7.1960 (traité de l’Elysée) ( En réalité, l'argent n’était pas parvenu aux Malgré-nous, mais, pour une partie, avait été affecté à l’équipement de la gendarmerie… mais ça, les Malgré-nous l’ignoraient ). « On fera payer les Allemands ! », tel sera le mot d’ordre ! Fort de cette promesse, les Malgré-nous furent ainsi tenus en état d’attente pendant des années. Ils militeront dans le parti gaulliste, colleront ses affiches électorales et assureront le service d’ordre de ses réunions.
Ce n’est finalement qu’en mars 1981, qu’un accord fut trouvé avec les Allemands pour le versement d’un fonds d’indemnisation spécifique. Ces derniers acceptaient de verser une nouvelle indemnisation de 250 millions de DM (env. 117,5 millions d’€). Les fonds furent débloqués en novembre 1981, soit 36 ans après la guerre, et versés à la fondation entente franco-allemande (Fefa) chargée des indemnisations ! Chaque incorporé de force, ou ayant droit, ne toucha que 1 387€… pour une jeunesse volée et, pour certains revenus handicapés, une vie brisée [8]!
La reconnaissance officielle ne viendra qu’en 2010
Mais toujours point de reconnaissance officielle de leurs souffrances et de leur statut de victimes. Il leur faudra encore attendre jusqu’au 8 mai 2010, jour où le président de la République, Nicolas Sarkozy, prononça un remarquable discours à Colmar dans lequel il rendait un vibrant hommage aux Malgré-nous alsaciens dont l’honneur et la dignité avaient si longtemps été bafoués : « Je suis venu en Alsace réparer une injustice », leur dira-t-il. Ce furent des victimes, des victimes du nazisme. Des victimes du pire régime d’oppression que l’histoire ait connu. Les victimes d’un véritable crime de guerre », martela-t-il, en ajoutant : « A leurs familles, à leurs enfants qui ont souffert aussi, aux survivants de cette tragédie, je veux dire que ceux qui les ont abandonnés, ceux qui n’ont rien fait pour empêcher cette ignominie perpétrée contre des citoyens français, ont trahi les valeurs de la France, l’ont déshonorée ».
De fait, il demeure que cette histoire tragique des Malgré-nous, que nombre de Français ne comprennent toujours pas, appartient en propre aux Alsaciens dont la quasi-totalité des familles furent touchées, de près ou de loin, par le drame de l’incorporation de force. L’histoire de ces hommes au destin tragique est pourtant la conséquence directe de la défection de la France qui n’a pas su protéger les Alsaciens en 1940, ses représentants ayant déserté le pays à l’arrivée des troupes allemandes, laissant la population seule et désemparée face au régime totalitaire nazi !
À Niederschaeffolsheim, sur une plaque commémorative en mémoire des incorporés de force, on peut lire ces quelques mots :
« L’incorporation de force : un drame alsacien majeur,
une injustice non réparée,
un souvenir douloureux,
une blessure jamais refermée ».
Bernard Wittmann
25.2.2025
[1] Au total, 21 classes ont été mobilisées en Alsace (14 en Moselle et 8 au Luxembourg).
[2] L’incorporation de force toucha, outre l’Alsace, la Moselle, le Luxembourg et le territoire germanophone de Belgique (Eupen-Malmédy).
[3] Les femmes incorporées de force dans les organisations nazies, RAD, KHD…, ont été désignées les Malgré-elles.
[4] Le NKVD était, dans l’URSS, un organisme d'État dont relevait la redoutable police politique chargée de combattre le crime et de maintenir l'ordre public.
[5] Le 7.7.1944, à grand renfort de propagande, l’URSS a libéré un premier contingent de 1500 prisonniers alsaciens-mosellans de Tambov. Affublés d’uniformes russes, ils passèrent d’abord par Téhéran, où ils reçurent des uniformes anglais, puis par Haïfa, avant de rejoindre, après un périple de deux mois, les Forces Françaises libres à Alger où on leur donna un uniforme américain. Ils auront donc fait la guerre sous quatre uniformes différents !
[6] Le procès d’Ouradour ne permit pas d’expliquer avec la sérénité nécessaire l’incorporation de force, les haines étaient encore trop fortes. Il ne donna finalement satisfaction ni aux uns ni aux autres.
[7] L’écrasante majorité des lettres de Malgré-nous adressées à leur famille sont écrites en Hochdeutsch (cf. Lettres de Malgré-Nous, témoignages d’incorporés de force, éd. La Nuée Bleue, 2012).
[8] En mai 1989, puisqu’il restait encore de l’argent dans les caisses de la Fefa, un versement complémentaire fixé à 1600 F, soit 243,92 €, fut encore effectué. Les bénéficiaires étaient alors au nombre de 82 850.